Saint Mandrier et Evenos
Saint Mandrier et le cimetière franco-italien. Evenos, le château et l'église Saint Martin.

Fermant la célèbre rade, tel un verrou, la presqu'île de Saint-Mandrier, aux temps les plus reculés, était formée de trois îles rapprochées devenues au cours des siècles « l'Isle de Sépet ». Les Phéniciens, les Rhodiens, les Ligures, les Celto-ligures, les Massadiens, les Romains s'y arrêtèrent. Ainsi, la baie du Creux Saint-Georges abrita de nombreux navigateurs et quelques huttes apparurent sur le rivage. Au VIe siècle, Six-Fours, La Seyne, l'Île de Cépet ne formaient alors qu'un seul territoire. Du VIe au XIe siècle, cette île n'était qu'un ensemble de fermes. Sa renommée provenait de la présence sur ses terres d'une tour phocéenne transformée en chapelle en 566 et de la chapelle Saint-Honorat avec son prieuré, datant de 1020.
1

En 1657, La Seyne obtient son indépendance communale avec bornage des terrains s'étendant jusqu'à la presqu'île de Sépet, car l'île était devenue presqu'île entre 1630 et 1657 grâce à la formation de l'isthme des Sablettes par ensablement. Le village, appelé aussi le Cros Saint-Georges commence à prendre forme et devient alors une section de la commune-mère La Seyne. En 1670, on construisit l'infirmerie royale Saint-Louis remplacée en 1818 par l'hôpital maritime de Saint-Mandrier. Tout au long du XVIIIe siècle, la vie à Saint-Mandrier a été intimement liée aux événements se déroulant dans la rade. L'indépendance de la commune a été proclamée le 24 avril 1950, et menée par Louis Clément, son premier maire. Le 24 avril de l'année suivante, Saint-Mandrier devient Saint-Mandrier-sur-Mer.
Le portail de l'église paroissiale a un fronton triangulaire.
2

L'église paroissiale. De son chevet plat s’élève un clocher de plan carré coiffé d'un campanile en fer forgé.
3

En 1845 une petite chapelle fut édifiée au Cros Saint Georges, au fond du port. La même année, elle fut érigée en église paroissiale. Elle se compose d'une nef unique avec abside à chevet plat, de deux chapelles latérales. Elle est voûtée en berceau plein cintre.
4

Mandrier et Flavien, soldats de la garde saxonne du roi arien Alaric II, furent convertis au christianisme par Saint Cyprien. Renonçant au métier des armes, ils se retirèrent sur l'île de Sépet et consacrèrent leur vie à Dieu. Venant en aide aux plus pauvres ou secourant les naufragés, leur bonté n'avait d'égal que leur foi. Persécutés par les hérétiques, ils auraient subi le martyre en l'an 566 sur cette même île de Sépet qui deviendra plus tard la presqu'île de Saint Mandrier. Les reliques de Saint Mandrier, Saint Patron de l'église, sont conservées à la cathédrale de Toulon dans la chapelle de Saint Cyprien.
5

En 1864 arrivent d'un village près de Naples des pêcheurs. De 1910 à 1936 des essais de sous-marins sont menés par Schneider. Le 18 novembre 1943, le village est évacué : il sera détruit à 70%.
6

7

8

Couvercle de sarcophage des Vème et VIème siècles, en calcaire jaune. Mis au jour en 1816 à l’hôpital militaire de Saint-Mandrier. Restitués par la marine à la commune en 2008.
9

Cimetière Franco-Italien. Située sur la route du sémaphore, la nécropole de Saint-Mandrier est créée en 1670 par Colbert. Dépendant de l'ancien hôpital de la marine, ce cimetière est pris en charge par le ministère des anciens combattante, le 8 décembre 1948. A l’intérieur de la partie française reposent des soldats et marins tués au cours ou des suites de la première guerre mondiale, notamment sur le front d’Orient : 1024 français, 22 combattants serbes, 18 grecs, 16 russes, et 1 bulgare reposent en tombes individuelles. Les restes mortels de 777 combattants français ont été rassemblés dans un ossuaire. En 1961, la partie sud-est a été cédée au gouvernement italien. Celui-ci a déposé, dans un columbarium, les restes de 975 soldats décédés dans le sud de la France au cours de la seconde guerre mondiale.
10

Cimetière Franco-Italien.
11

Cimetière Franco-Italien. Il est donc formé de deux parties. La première, mise en forme en 1922, pour les soldats français et étrangers des Balkans, morts durant la 1ère guerre mondiale. La seconde, créée en 1961, pour les soldats italiens. Cette réorganisation fut terminée en1963.
12

Cimetière Franco-Italien. Partie française où reposent des soldats et marins tués au cours ou des suites de la première guerre mondiale, notamment sur le front d’Orient.
13

Cimetière Franco-Italien.
14

Cimetière Franco-Italien. Partie Italienne.
15

Cimetière Franco-Italien. Partie Italienne.
16

Cimetière Franco-Italien. Partie Italienne.
17

Cimetière Franco-Italien. Partie Italienne. Columbarium renfermant les restes de 975 soldats décédés dans le sud de la France au cours de la seconde guerre mondiale.
18

Cimetière Franco-Italien. Partie Italienne. Columbarium renfermant les restes de 975 soldats décédés dans le sud de la France au cours de la seconde guerre mondiale.
19

Cimetière Franco-Italien. Partie Italienne. Columbarium renfermant les restes de 975 soldats décédés dans le sud de la France au cours de la seconde guerre mondiale.
20

Cimetière Franco-Italien.
21

Cimetière Franco-Italien. Tombe de quatre soldats français morts en service aérien commandé le 14 octobre 1964.
22

Cimetière Franco-Italien.
23

Cimetière Franco-Italien.
24

Cimetière Franco-Italien. Une pyramide, haute de 8 mètres, ornée de deux sphinx, est érigée en septembre 1810. Elle renferme la dépouille du vice-amiral Latouche-Treville, grand officier de l'Empire, commandant en chef des Forces Navales de la Méditerranée, décédé en rade de Toulon le 17 août 1804 à bord du vaisseau Le Bucentaure.
25

Cimetière Franco-Italien. Tombeau renfermant la dépouille de Marie-Nicolas Ravier, capitaine de l’armée d’Orient, « mort pour la France » le 8 octobre 1917 et portant l’inscription : « En reconnaissance des soins donnés à son fils Marie-Nicolas. Ravier de Dounemari a légué, le 8 janvier 1919, la moitié de sa fortune à l’Hôpital de Saint-Mandrier ».
26

Cimetière Franco-Italien. Un monument est érigé à la mémoire des officiers du Service de Santé de la Marine, du personnel soignant et des religieuses, décédés à l’Hôpital maritime de Saint-Mandr
27

Domaine de l’Ermitage. Aux portes de l’agglomération toulonnaise, bordant la plage de la Coudoulière au sud de la presqu’île de Saint-Mandrier, cette propriété agricole de la fin du XIXème siècle constitue l’un des derniers témoins des propriétés rurales du littoral varois. Dominé par une maison de maître et d’anciens bâtiments d’exploitation, ce domaine allie une pinède de pins d’Alep abritant un maquis dense, une prairie avec d’anciennes cultures méditerranéennes, et des falaises maritimes offrant un panorama exceptionnel. Préservée de l’urbanisation environnante, cette propriété est désormais sauvegardée pour toujours par le Conservatoire du littoral dans un double objectif de préservation et de valorisation, en partenariat avec la commune.
28

A la fin du 19e siècle, Paul Juvénal, avocat à la cour de Toulon, fait construire la maison de maître et les bâtis agricoles sur l’arrière-plage de la Coudoulière. Il décède en 1940, et ce n'est qu'en 1952, après le règlement de la succession familiale, que son neveu, Maximin dit Max, prend possession des lieux. Avocat à la Cour d'Aix-en-Provence, il a joué un rôle primordial dans l’unification de la Résistance en Provence, et présidera le Comité de Libération à Marseille. Après ses mandats de Député et Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, il s'installe sur le Domaine agricole de son oncle à Saint Mandrier, où il devient conseiller municipal dès 1965 puis maire (1970-1984). A son décès, les parts d'indivision d’une branche de la famille sont cédées à une société civile immobilière, qui se retrouve en copropriété avec Max fils (l'un des fils de Max Juvénal).
29

Pendant des années, la propriété, partiellement constructible dans les documents d'urbanisme, est l'enjeu de polémiques locales quant à sa constructibilité et sa protection. Max Juvénal décidera finalement de céder la propriété au Conservatoire du littoral, afin d’éviter le morcellement du Domaine.
30

Suite à l'acquisition de la propriété en 2007, un ambitieux projet de réhabilitation du domaine de l’Ermitage est élaboré dès 2008, et approuvé par enquête publique en 2010. L’une des priorités aura été de restaurer le patrimoine bâti du site. La rénovation de la maison de maître, de l'ancienne ferme et des autres édifices a été finalisée en 2015.
31

Deux puits sont présents sur le domaine, un puits voûté situé dans le vignoble et le second aux abords de la maison de maître, muni d'un dispositif de pompage que l'on appelle noria. La noria est constituée d'une roue à godets qui était autrefois actionnée par la force animale, et utilisée pour envoyer l’eau du puits vers des canaux secondaires qui permettaient l’irrigation de l'ancien potager, des plantations, et du poulailler.
32
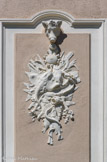
La pêche.
33

La chasse.
34

35

36

37

L'ancien hôpital militaire. En 1658, un lazaret est créé. Il restera en fonction jusqu'en 1898. Il accueillera, entre autres, le général Desaix, Champollion, l'émir Abd-el-Kader. En 1818, cet hôpital est créé. Il restera en fonction jusqu'en 1936, année de l'ouverture de l'hôpital Sainte Anne à Toulon.
38

La région fut habitée par les peuplades Celto-ligures (plusieurs siècles avant notre ère), puis les templiers créèrent une léproserie dans les gorges du Destel. Sur les vestiges d’une tour grecque en ruine, les romains y construisirent un oppidum. Le village fut détruit plusieurs fois par l’invasion de Sarazins, les habitants ont donc commencé à construire le château féodal au Xème siècle. St Louis séjourna à Evenos au retour d’une croisade et Evenos montagne comme on l'appelle aujourd'hui (Nèbre pour les natifs) fut longtemps le chef-lieu de la commune qui regroupe aujourd’hui encore Evenos montagne, le hameau du Broussan blotti dans sa cuvette et le hameau de Sainte Anne, dans la plaine qui ouvre sur le Beausset et par où passe la route nationale de Toulon à Marseille, autrefois route royale qui pour ces raisons, deviendra le centre administratif de la commune moderne.
39

Le village est ancré à 432 m sur une coulée de lave datée d’environ 6 millions d’années. Le volcanisme de la région d'Evenos est très ancien, il remonte à la fin du tertiaire il y a 10 millions d’années. Et les dernières coulées de lave datent de 6 millions d'années. Les laves ont été émises soit par des fissures soit par des cratères. La coulée volcanique dont le départ viendrait du rocher de l’Aïgue (Le Beausset) auraient parcouru environs 15 km recouvrant la Piosine, Evenos, la Courtine, la zone des playes, pour arriver – épaisses de 15 m – à la pointe nègre (Six Fours). . La batterie Napoléonienne du cap Nègre a été construite avec les roches volcaniques. La roche basaltique est de plusieurs couleurs, dues à sa forte teneur en oxyde de fer.
40

Le château est à son origine construit en basalte et calcaire, des roches qui lui donnent toute sa spécificité : une double coloration saisissante et surprenante. Dominant la plaine côtière toulonnaise et les gorges d'Ollioules, le château d'Evenos trône fièrement en véritable forteresse de montagne.
41

42

Le fort de Pipaudon. Construit en 1893-1895, à 406 m d'altitude. Sa garnison était composée de 360 hommes, 12 canons et 2 mortiers. Il commandait la route venant de Marseille et les gorges d’Ollioules. Dernier ouvrage construit dans la place ; en conformité avec l’usage du moment, il comporte de nombreux locaux creusés dans le roc dont des magasins et un monte-charge.
43

Au centre, les grès d'Evenos, à gauche la carrière du Val d'Aren. Au fond, le cap Canaille et à droite, la Grande Candelle.
44

La barre des Aiguilles du Cimaï
45

Le donjon est de forme pentagonale, il abrite une chapelle dédiée à Saint-Pierre.
46

La construction du château d'Evenos a débuté en 1141, sous le règne de Louis VII le Jeune (1137-1180). Le château va connaître un premier développement un peu moins d'un siècle après sa fondation, avec la construction de son donjon vers 1230. Son donjon pentagonal, installé à la pointe de l'éperon pour faire face à l'attaque semble imprenable. Au cours des siècles, le château d'Evenos va passer de main en main, et connaître bon nombre d'agrandissements et d'embellissements. Au début du XIVème siècle, le château va se parer d'une tour circulaire, appelée également "Tour Blanche", ainsi que d'une enceinte en pierre calcaire. Au cours des siècles, le château va subir de nombreuses tentatives de conquêtes mais ces assauts resteront vains.
47

Le château est Installé le long d'une crête volcanique, ses fondations épousent parfaitement la verticalité de cette crête.
48

Le donjon pentagonal, planté à la pointe de l'éperon, face à l'attaque, semble imprenable.
49

Le château d'Evenos va connaître une véritable modernisation à la fin du XVIème siècle, sous la direction de Gaspard II de Marseille-Vintimille, qui va notamment apporter au logis une façade Renaissance. Malgré ces travaux d'embellissement, le Château garde ses fonctions militaires jusqu'en 1793, date du siège de Toulon par l'armée républicaine. Au cours du XXème siècle, le château devient une propriété privée avec son logis qui sera habité jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après avoir longtemps appartenu à la famille Daniel, réputée au village d'Evenos, le château a été revendu en 2012 à un particulier qui souhaite le transformer en habitation. Les travaux de réhabilitation transforment peu à peu le lieu et redonne les lettres de noblesse au château.
50

Le chemin de ronde.
51

Pierres en bossage.
52

• 1141. Evena serait cité. • 1148. Castro Evene est mentionné. • 1150. Evena est cité dans le Cartulaire de l’Abbaye Saint-Victor de Marseille. • 1150 : le castrum est partagé entre le vicomte et le chapitre de Marseille. • v. 1230 : le donjon est construit. • v. 1297 : le comte de Provence possède des parts sur Evenos. • 1313-1324 : ce dernier cède ses parts à Bertrand de Signes. • 1315 : Bertrand de Vintimille hérite d'Évenos. • 1524 : le château résiste aux troupes de Charles Quint, commandées par Charles de Bourbon. • 1592 : face au duc de Lesdiguières, les « carcistes » tiennent la place. Le capitaine Isnard d’Ollioules se distingue par sa défense farouche. • Fin XVIe - début XVIIe : le logis est modernisé. • 1793 : lors du siège de Toulon, l'armée républicaine s'empare du château. • Après 1945 : le château est pillé et vandalisé
53

Le château d'Evenos va connaître une véritable modernisation à la fin du XVIème siècle, sous la direction de Gaspard II de Marseille-Vintimille, qui va notamment apporter au logis une façade Renaissance. Malgré ces travaux d'embellissement, le Château garde ses fonctions militaires jusqu'en 1793, date du siège de Toulon par l'armée républicaine. Au cours du XXème siècle, le château devient une propriété privée avec son logis qui sera habité jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après avoir longtemps appartenu à la famille Daniel, réputée au village d'Evenos, le château a été revendu en 2012 à un particulier qui souhaite le transformer en habitation. Les travaux de réhabilitation transforment peu à peu le lieu et redonne les lettres de noblesse au château.
54

55

56

57

58

La grande cour du château se termine par une tour ronde dite « Tour Blanche ».
59

La grande cour du château se termine par une tour ronde dite « Tour Blanche ».
60

La grande cour du château se termine par une tour ronde dite « Tour Blanche ».
61

Mur d'enceinte.
62

Mur d'enceinte.
63

Eglise paroissiale Saint-Martin. Eglise fortifiée. Accès à sa terrasse de défense par un escalier partant du chemin de ronde. Au 18e siècle, rajout d’un un toit et d’un clocher-mur à deux baies. L’existence de ce toit-terrasse confirmerait que l’église était fortifiée et que la hauteur sous voute était plus importante.
64

Eglise paroissiale Saint-Martin.
65

Poterne fortifiée appelée « grand portail ».
66

67

Les maisons sont construites avec des roches volcaniques, les siècles et l'oxydation du fer ont parés les moellons de couleurs variées allant du gris au marron.
68

Eglise paroissiale Saint-Martin. Eglise romane du XIIIe siècle, construite en pierres de basalte et de calcaire. Avec son système de défense à toit -terrasse découvert lors des travaux de restauration, elle était un véritable bastion avancé pour la défense du rempart Est, à l’entrée du village.
69

Eglise paroissiale Saint-Martin. L’église, construite en forme de rectangle de 20,5 m sur 8 m est divisée en trois travées séparées par un arc doubleau. Les murs latéraux droits de la nef possèdent des arcades aveugles retombant sur des sommiers taillés en doucine.
70

Eglise paroissiale Saint-Martin. Trois baies et l’oculus du mur pignon éclairent la nef dans laquelle nous trouvons différentes expressions d’« art sacré ».
71

Eglise paroissiale Saint-Martin. La vierge au-dessus de l’autel, au visage de l'impératrice Eugénie de Montijo.
72

Eglise paroissiale Saint-Martin.
73

Eglise paroissiale Saint-Martin. Le tableau de Saint Martin (18e siècle), l’autel tombeau Napoléon III en marbre blanc et le buste reliquaire du saint patron.
74

Eglise paroissiale Saint-Martin. Le tableau de Saint Martin (18e siècle), avec, à gauche, Saint Jean-Baptiste et à droite, Saint Pons.
75

Eglise paroissiale Saint-Martin.
76

Eglise paroissiale Saint-Martin.
77

Eglise paroissiale Saint-Martin. Les bannières de Saint Martin du 19e siècle
78

Eglise paroissiale Saint-Martin. Les bannières de Saint Martin du 19e siècle
79

Eglise paroissiale Saint-Martin. La Cène.
80

Eglise paroissiale Saint-Martin. Les fonts baptismaux.
81

La crèche de Renée et André Andréini. C’est une crèche de Provence, comme beaucoup de crèche l'on y retrouve les personnages de la crèche, mais réalisés de façon originale et en matière différente de l'argile traditionnelle.
82

La crèche de Renée et André Andréini.
83

La crèche de Renée et André Andréini.
84

La crèche de Renée et André Andréini.
85

La crèche de Renée et André Andréini.
86

La crèche de Renée et André Andréini.
87