Chalon sur Saône
La ville ancienne, la cathédrale Saint-Vincent, le musée Niepce, l'église Saint-Pierre, le musée Denon, l'ancien hôpital.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111
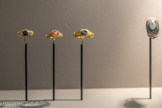
112

113

114
![Le dépôt de Verjux IIIe siècle.
Vaisselle métallique : chaudron, passoire.
Monnaies contenues dans un pot 139 sesterces / 1 antoninius
Découvert à une trentaine de mètres d’un bâtiment gallo- romain sur la commune de Verjux (71), le trésor monétaire — constitué de 139 et 1 antoninius rassemblés dans un pot—, une passoire en alliage cuivreux et un fragment de terre cuite blanche représentant une tête de Vénus a été découvert déposé dans chaudron en bronze, Ce dépôt présente un intérêt tout particulier car l’étude des monnaies a révélé une thésaurisation de plus de 150 ans [fin du Ier - milieu du IIIe siècle], Cette durée témoigne de faits rares en archéologie : l’assurance de la transmission d’un patrimoine sur plusieurs générations.](./thumbnails/_K1_7947.jpg)
115

116
![Ensemble des 13 pointes foliacées de la cachette de Volgu.
Environ -18 000 ans.
Les pointes de Volgu : un ensemble extraordinaire, par le choix maîtrisé de la matière première.
Le silex utilisé pour la fabrication des pointes de Volgu est de grain fin, homogène, sans défaut. Il doit se présenter sous forme de dalles d’au moins 30 cm de longueur.
Les différences de couleur visibles ont longtemps suggéré un approvisionnement aléatoire, effectué au gré des déplacements.
En réalité, un récent programme de recherches a révélé que le silex utilisé est extrait d’un seul secteur de la vallée de la Loire, à 150 km au nord-ouest de Volgu.
Par des proportions à la limite de la rupture
D’une taille comprise entre 23 et 37 cm pour une épaisseur n’excédant jamais 9 mm, elles reflètent une volonté de pousser l’art du façonnage lithique à la limite du point de rupture. Par l’excellence du geste L’observation minutieuse des pointes met en avant deux séries un peu différentes : une plutôt large, l'autre plus élancée.
Plusieurs hypothèses en découlent :
- cet ensemble aurait pu être réalisé par plusieurs artisans [au moins deux], identifiables grâce à ces légères différences techniques. / un seul artisan aurait également pu fabriquer ces pointes et les différences de traitement seraient alors le résultat d’une évolution de ses capacités techniques dans le temps.
- enfin, il se peut que le ou les artisans ai[en]t été obligé[s] de s’adapter aux aléas provoqués par la préparation des surfaces [fissures, fractures accidentelles de la forme d'origine etc].](./thumbnails/_K1_7982.jpg)
117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133
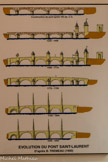
134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212