Beaune
La ville, les Hospices, la collégiale Notre Dame avec les tapisseries de la Vierge, Hôtel des Ducs de Bourgogne.
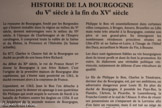
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

La sœur apothicaire. A ses débuts et jusqu’au XVIIIe siècle, l’équipe de l’apothicairerie était probablement composée d'une sœur responsable, d’une sœur plus jeune en apprentissage chargée de la seconder ainsi que d’une servante. L'Hôtel-Dieu a conservé le portrait de l’une de ces sœurs en charge de l’apothicairerie au XVIIe siècle : Sœur Pierrette Monnet (1557-1628) représentée avec un mortier et son pilon à la main, symbole de sa fonction (sur le mur). L’apprentissage de l’art de soigner étant délicat, les sœurs apothicaires étaient choisies par la maîtresse et ne changeaient pas de fonction tous les 3 ans comme les autres sœurs. Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, à l’instar de nombreuses pharmacies hospitalières et sans que l'on sache la véritable raison, l’Hôtel-Dieu nomme un apothicaire de la ville comme responsable. Est-ce pour éviter les irrégularités qui ont peut-être été constatées lors de la préparation des médicaments ?
110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244